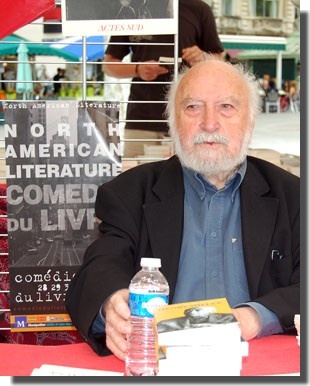 C’est par un bel hiver gelé qu’il faut faire le voyage de Concord qui est une paisible et campagnarde petite cité non loin de Boston. C’est là que vit le jour le 12 juillet 1817 Henri David Thoreau, c’est en ce lieu qu’il mourut le 6 mai 1862 à peu près inconnu, sauf de quelques uns de ses pairs et de quelques spécialistes.
C’est par un bel hiver gelé qu’il faut faire le voyage de Concord qui est une paisible et campagnarde petite cité non loin de Boston. C’est là que vit le jour le 12 juillet 1817 Henri David Thoreau, c’est en ce lieu qu’il mourut le 6 mai 1862 à peu près inconnu, sauf de quelques uns de ses pairs et de quelques spécialistes.
Ses amis étaient , le philosophe Ralph Waldo Emerson, et Walt Whitmam. On s’étonne toujours que dans cette petite ville de Concord, pas plus grande que Lunel par exemple, il y ait eu une agglomération de talent et même de génie, à ce point que l’on se demande vraiment si le climat n’y est pas pour quelque chose. Encore aujourd’hui rares sont ceux qui reconnaissent en Thoreau l’un des écrivains américains les plus marquants de ce siècle. Concord n’a pas tellement changé depuis le temps d’Emerson et de Thoreau. Cette bourgade propre et claire vit sans histoire à l’ombre de ses grands hommes. Ses cottages parmi lesquels on remarque les maisons pieusement conservées d’Emerson, d’Alcott et de Nathaniel Hawthorne, la petite église au toit pointu, tout ici appartenait à la vieille Angleterre, agreste, aristocratique et puritaine. Il est surprenant de noter que c’est à Concord, dans ce paysage verdoyant qui rappelle le Sussex, que l’on entendit les trompettes de l’indépendance sonner le départ de la révolte contre l’ancienne patrie, au nom de la jeune Amérique.
Peut-être Henri David Thoreau tenait-il le goût de l’indépendance d’un grand-père corsaire et Normand, d’où son nom, et aussi de son père qui pendant la brève période où il fut colporteur, effectuait ses tournées du côté de la « Frontière » et descendait en pirogue les rivières rapides en compagnie d‘Indiens. Mais à coup sûr se furent la nature environnante, les forêts, les cours d’eau de la région tel que le Merrimac ou celui qui prit le nom de la ville après avoir longtemps gardé son nom indien de « Musketaquid ».
Refusant les emplois lucratifs et réguliers, il s’embauche çà et là comme jardinier, terrassier, maçon. C’est alors que Ralph Waldo Emerson, poète panthéiste, le seul poète américain avant Whitman, bien fait pour séduire ce jeune sauvage, se prend d’amitié pour Thoreau. Chez lui on rencontre la poétesse féministe Margaret Fuller, le végétarien Bronson Alcott, le rousseauiste William Ellery Channing, le romancier Nathaniel Hawthorne, tous personnages pétris de puritanismes, épris d’idéal, et qui formaient à Concord le groupe des Transcendantalistes avec leur Université Populaire et la célèbre revue, The Dial (le Cadran).
Recueilli chez Emerson, Henri s’ingéniait à rendre service par tous les moyens, si bien qu’on a pu écrire qu‘il était devenu « le domestique des philosophes »; ce qui est bien peu connaître le caractère orgueilleux de ce farouche indépendant. De fait l’« Oncle Henri » s’occupait de tout, du jardin comme du secrétariat, de la réparation des serrures comme des jeux des enfants, ainsi qu’il avait toujours fait où qu’il se trouva.
Une nouvelle expérience se présente alors à Thoreau. Emerson l’adresse à son frère, établi à New York, et qui a besoin d’un précepteur pour ses enfants. Là Thoreau se heurte à la vie d’une grande métropole. Bien entendu, il se détourne et pense qu‘être riche c‘est au contraire avoir peu de besoins, qu’il faut limiter son champ d’action, s’accrocher à la « Petite Patrie », à Concord, aux paysages connus…
Lourdement chaussé, coiffé d’un vieux chapeau cabossé, vêtu de solide velours, il ressemble plus que jamais au sentencieux et honnête « Bas de cuir » (le personnage de Fenimore Cooper et du Dernier de Mohicans) au risque de n’en paraître qu’une parodie ou ce qui serait pire de se présenter comme un «pike» ce type de blanc retombé à l’état sauvage.
Ce n’est point tant pour trouver la solitude qu’il s’enfonce dans les forêts mais parce que déjà cette solitude est en lui-même. Ce n’est point un passionné comme Rousseau, il ne voit pas la nature avec des yeux de Théocrite ou de Virgile, mais l’étudie en spécialiste, la prend telle qu’elle se présente. Thoreau si idéaliste qu’il soit agit en réaliste; chez lui on ne trouve pas de misanthropie, Thoreau n’est pas un Alceste, un dépité ou un amer. Il est contre par nature. Aussi ne reste-t-il pas longtemps à New York.
En 1845 donc à 28 ans, il construit une cabane sur les bords de Walden Pond, l’étang de Walden, à l’orée d’un bois de bouleaux argentés. Dès le mois de décembre une épaisse couche de glace recouvre l’étang, la neige ensevelit la terre. Seuls les arbres nus offrent au regard leurs bras noirs.
Il y vivra pendant deux ans, jardinant, coupant du bois, lisant et surtout écrivant quotidiennement son journal, d’où son livre le plus célèbre « Walden » sera extrait. Il y exalte la vie naturelle mais sans la farder, décrivant ce que son oeil de savant observait, méditant sur la vanité du mouvement, sur l’Amérique nouvelle des hommes d’affaires. Il ne se hasarde plus que très rarement à Concord, où il est mis un jour en prison pour n’avoir pas voulu payer ses taxes. Pourquoi payer, s’indigne -t-il, puisque je n’ai rien de commun avec la ville. Réfractaire jusqu’au bout donc, il regrette que ses parents aient versé la somme qui le libère de la ville.
En 1847 Thoreau se retrouve gardien de la maison d’Emerson alors en tournée de conférences en Europe. Il a fait paraître son premier livre « Une semaine sur les fleuves Concord et Merrimac (A Week on the Concord and Merrimack Rivers) », mais à compte d’auteur. Sur mille exemplaires tirés, deux cents seulement sont vendus. Non sans humour triste, il écrit : « j’ai maintenant une belle bibliothèque dont 800 volumes ont été écrits par moi ». Pour éponger un tel déficit il faut travailler. La fabrique de crayons le voit donc revenir et avec lui de nouvelles ères de prospérité. Mais Thoreau ne pouvait longtemps revêtir l’habit de l’homme d’affaires. Il lui faut autre chose et surtout sa liberté.
Enfin il trouve un métier pour lui, il devient arpenteur. Le voilà donc pour un dollar par jour, sur les routes à travers les bois, dans la neige, dans la vase des marécages quel que soit le temps. Et ce métier ne l’empêche pas reprendre ses voyages : à Cape Cod, où il va entendre l’océan gronder, à Fire Island, près de New York, où il va identifier le cadavre de Margaret Fuller qui s’est noyée lors d’un naufrage en rentrant d’Italie en 1850; au Canada où il est enchanté par des noms français des lieux, des gens et des rivières; sur des lacs du Maine en compagnie d’un guide Peau-Rouge.
En 1854 « Walden » est publié, second et dernier de ses ouvrages à paraître de son vivant et comme le remarque Joseph Wood Krutch dans son livre sur Thoreau: « un des très rares ouvrages américains considéré dans le monde entier comme un classique ». L’un des livres les plus universellement lu du siècle.
Ainsi se déroulera cette vie durant quelques années encore partagée entre l’écriture, la lecture, les vagabondages, les prises de position qui risquent de le mener devant les tribunaux, en faveur de l’individu brimé, de l’anarchiste poursuivi. Il donne ses dernières forces à l’action sociale, prend violemment parti dans ses discours publics, contribue à accélérer le mouvement des esprits vers ce qui va bientôt dresser les Américains les uns contre les autres: la guerre civile.
Il entreprend alors un long voyage vers le Niagara, remonte le Mississippi, traverse la prairie dans un chariot d’émigrant, pénètre en territoire des Sioux et ces derniers organisent des danses en son honneur. Il ne cesse de noter ses observations sur la faune et la flore en bon botaniste qu’il est.
Au bout de deux mois il rentre à Concord, va revoir à Walden sa cabane abandonnée. En 1861 la Guerre Civile éclate.
L’état de santé de Thoreau n‘est pas bon. Ses amis viennent lui rendre visite; il continue malgré la fièvre son journal et ses lectures et sentant sa fin proche, classe ses papiers, met de l’ordre dans ses maigres affaires. Il rend le dernier soupir le 6 mai 1862 à l‘âge de 45 ans. Tout le monde est là à son chevet sauf Walt Whitman qui est brancardier sur le front.
Henry David Thoreau repose dans le cimetière sylvestre et vallonné de Sleepy Hollow, aux portes de Concord parmi les mélèzes et les bouleaux argentés. Non loin de sa tombe on peut voir aussi des blocs de pierres dure sur lesquelles sont gravés des noms de Alcott, Hawthorhe ou Emerson.
Là-bas, à Walden Pond, la cabane n’existe plus. Je n’ai pu voir sur les berges gelées de l’étang que des traces de ses fondations. Mais le paysage reste inchangé, épargné encore par les hommes, sauvage comme au jours de Thoreau, tel qu’il rêvait de le conserver pour la Libre Amérique.
S’il est vrai que l’oeuvre d’un écrivain se détache de lui une fois conçue comme le fruit d’un arbre, il n’est non moins évident que les liens demeurent et rattachent cette oeuvre, pour aussi indépendante qu’elle soit, à la vie même de l’auteur. En face d’un personnage comme Thoreau, cette vérité première est de nouveau confirmée. On s’est souvent demandé si Thoreau voulait être écrivain. Dès le collège il écrivait des poèmes, dont certains devaient paraître dans The Dial, mais il ne différait pas de la majorité des jeunes gens qui commencent à s’exprimer. On rapporte que c’est devant les critiques abruptes d’Emerson qu’il détruisit la majorité de ses poèmes et décida de se tourner vers la prose.
Qu’il l’ait regretté ne semble pas prouvé et si l’on se réfère à ce qu’il notait : » Une grande prose d’égale élévation commande notre respect plus qu’une grande poésie, pour ce qu’elle implique une attitude plus stable, une vie davantage fécondée par la hauteur de la pensée. Le poète est souvent impulsif comme un parthe et décoche sa dernière flèche tandis qu’il bat en retraite. Mais le prosateur serait plutôt un conquérant romain qui établit des comptoirs « .
Quoi qu’il en soit, c’est désormais en prose qu’il écrira jusqu’à sa mort. Il est vrai que l’essentiel de son oeuvre, ou plutôt l’oeuvre toujours en expansion qu’est son journal, ne pouvait qu’adopter naturellement ce mode d’écriture. Il le tiendra pendant une vingtaine d’année, sans relâche, aboutissant à ce monument unique dans l’histoire de la littérature de trente neuf volumes manuscrits. Une phrase nous instruit des soucis d’écrivain » J’ai un cahier de notes pour les frais, un autre pour la poésie, et je trouve souvent difficile de maintenir cette distinction vague que j’avais en esprit, car les faits les plus intéressants et les plus beaux sont les plus poétiques et c’est là leur force«. Cela me rappelle une phrase de Novalis disant que plus une chose est réelle, plus elle est poétique.
On notera l’emploi du mot « poésie » qui viendra souvent sous la plume de Thoreau et qu’il faut prendre bien entendu dans son sens large; cette distinction, l’écrivain et le naturaliste qui sont en lui la feront de moins en moins. Il est cependant remarquable que lorsque Thoreau voudra publier une partie de ses notes l’écrivain en lui finira par altérer la pureté des impressions du naturaliste.
Les ambitions de Thoreau sont des plus exigeantes et des plus modestes à la fois : « Je veux vivre de telle sorte que je tire ma joie et mon inspiration des évènements les plus ordinaires et des faits de chaque jour ». Comme Emerson il pense que l’éternel est contenu dans le présent et il proclame: « c’est en moi que les saisons se trouvent, je crois que la vie extérieure et la vie intérieure coïncident; le monde extérieur n’est que l’envers de ce qui au dedans de nous » .
Si la vie est souvent sans pitié, elle n’en n’est pas moins belle et véridique. La nature de Thoreau n’est pas celle des bergeries, des parties de campagne à la Watteau. Il est bien de fils de cette Amérique sensible à l’appel de la vie sauvage; Thoreau dans les bois de Concord se sentait devenir Peau-Rouge ou pionnier comme London, Melville, Whitman. Mais solitaire et paisible, il allait à travers champs et forêts, plus semblable au David La Gamme du Dernier des Mohicans qu’aux tueurs de daims.
Il est peu d’exemple d’écrivains ayant envers eux-mêmes plus de sévérité allant jusqu’à l’injustice, car précisément le souci de Thoreau est de polir ses phrases, mais en même temps il n’ignore pas qu’il risque ainsi d’endiguer sa pensée, de lui enlever le jaillissement initial; le style de Thoreau oscille alors entre la simplicité et une certaine redondance due à l’emploi de métaphores. Le journal est davantage dédié à la nature, aux arbres et aux animaux, qu’aux critiques de la société du temps.
On pourrait multiplier les citations, montrer les mérites de l’écrivain, principalement dans le Journal, qui demeure l’œuvre maîtresse de Thoreau.Laissons à chacun le plaisir de lire ou de relire Walden, de découvrir un homme qui se décrivait sans doute inconsciemment en écrivant que « ce serait un vrai poète celui qui pourrait parler avec la voix du vent et des ruisseaux. »
 USA Decouverte Votre guide de voyage aux Etats-Unis
USA Decouverte Votre guide de voyage aux Etats-Unis


